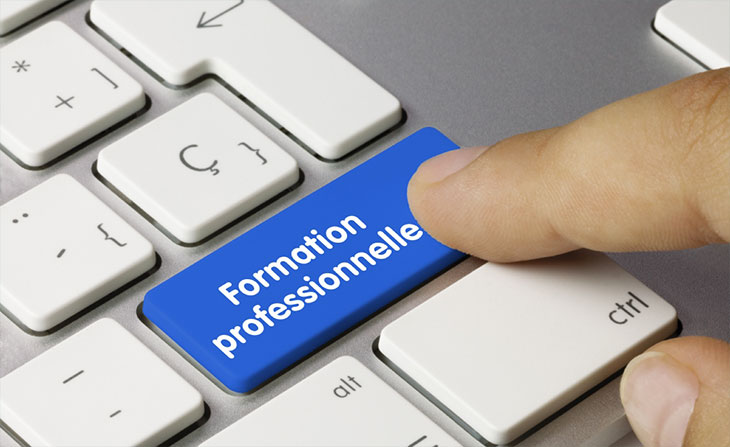Vive la montée du coaching dans les PME !
De plus en plus de dirigeants de PME optent pour le coaching, convaincus de l’efficacité de l’outil pour doper la croissance de leur entreprise et du retour sur investissement en termes financier et de bien-être collectif.
La Société Française de Coaching, organisation référente du coaching professionnel en France, observe une adoption grandissante du coaching dans les PME au profil de leader et de challenger. Très utilisé dans les grandes entreprises qui reconnaissent son efficacité depuis 20 ans, le coaching fait son entrée depuis quelques années dans les petites structures.
Les PME constituent l’essentiel du tissu économique français. Caractérisées par un effectif de moins de 250 personnes, elles génèrent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros. Elles représentent près de 50% de l’emploi salarié total de l’Hexagone, répartis entre 3 millions de petites entités.
Une part significative de celles-ci a intégré le coaching dans ses pratiques courantes. Il s’agit de celles dotées d’un profil de leader et de challenger ; les autres étant encore freiné par certaines réticences qui tendent à s’estomper, mois après mois.
Des obstacles à lever
Parmi les freins existants dans les PME encore rétives au coaching, Il est identifié :
La méconnaissance. Le processus et les modalités du coaching sont flous pour les décideurs des PME. Ils s’interrogent sur ce type d’accompagnement où on n’apporte pas de solution mais des questions. Un accompagnement de la personne et qui est très vite qualifié, à tort, de psychologique et donc, rejeté.
Des freins culturels. « Les personnes de culture latine sont peu enclines à se faire accompagner« , indique Jean-Luc Andrianarisoa, administrateur de la SFCoach. « Seuls les « faibles » se font accompagner, pensent-elles souvent. D’une certaine façon, il est bien plus glorieux d’avoir échoué tout seul que d’avoir réussi en ayant été accompagné. C’est pourquoi une partie des PME françaises est touchée par les syndromes NIH (Not Invented Here), et NSS (nous sommes spéciaux). Des syndromes qui leur font penser qu’une aide extérieure ne leur apporterait rien« . Et pourtant, quel que soit le domaine, le secret du champion par rapport aux athlètes qui s’entrainent beaucoup, repose sur son accompagnement et sur le soutien d’un « staff ».
La législation et les coûts. Le coaching n’entre pas jusqu’à présent dans le budget formation. Il s’agit donc d’un réel investissement, considéré pour certaines comme onéreux, avec un montant moyen du coaching en PME situé entre 4500 et 8000 euros.
Résoudre des problématiques RH avec le coaching…
Un certain nombre de PME ont bien compris l’utilité du coaching et franchi le pas :
Les leaders et challengers pensant que pour jouer dans la cour des grands, il faut se doter des mêmes moyens que ces derniers.
Les PME dirigées par des humanistes convaincus misant sur le capital humain,
Les entreprises familiales où l’affectif prime et qui sont aux prises de problèmes humains parfois inextricables, générant de la souffrance chez ses encadrants.
et tout récemment, avec la multiplication des affaires réelles ou supposées de harcèlement, où les PME voient dans le coaching un moyen de s’en sortir par le haut.
…Ou des problématiques de management
D’autres PME optent pour le coaching en réponse d’un besoin situé au niveau du Management de direction. Ayant accompagné avec loyauté et efficacité la croissance de l’entreprise, des responsables de service se voient confier des responsabilités de direction, alors que la gouvernance était jusqu’à lors l’affaire du patron dans les entreprises familiales. Le coaching va alors leur permettre de prioriser leurs activités et donc de déléguer, afin de pouvoir exercer la mission de management de l’entreprise, c’est-à-dire de participer aux décisions de fonctionnement du collectif de l’entreprise. Ils vont aussi, dans cet accompagnement, travailler leur capacité à prendre du recul, développer leur leadership et faire évoluer leur identité managériale.
Les PME sont souvent structurées autour d’un Comité de direction (CoDir ou ComOp, pour Comité opérationnel). L’entreprise grandissant en taille et en activités doit organiser ses processus opérationnels et de décision. Le pouvoir autrefois concentré chez les dirigeants fondateurs va s’étendre aux managers qui vont être aux premières commandes de l’entreprise. Les principaux responsables de départements formant ce CoDir, vont partager vision et décisions sur de nombreux sujets : la communication, le management et la politique de rémunération, la qualité de service, le développement de nouvelles activités. « Il en résulte, pour cette entité CoDir, la nécessité de former une équipe qui ne soit pas la somme des besoins et intérêts de chacun des départements, mais qui soit une véritable équipe, une vraie instance de décision et de coopération« , précise Chantal Motto, vice-présidente de la SFCoach.
Le coaching d’équipe va permettre de construire une cohésion du collectif et de définir ensemble des processus de fonctionnement : du CoDir lui-même, des processus opérationnels transverses et alignement du projet stratégique de l’entreprise avec les objectifs par département.
Des résultats fixés d’avance
Nombre de dirigeants de PME sont séduits par le fait que le coaching est le seul protocole d’accompagnement pour lequel les critères de réussite sont fixés d’avance. Le processus type d’un coaching professionnel intègre en effet une évaluation formelle de l’efficacité de l’accompagnement au regard de ses résultats attendus, dans le cadre d’une réunion dite « tripartite » entre le coaché, un représentant de l’entreprise (le N+1 et/ou un RH) et le coach. Le coaching est donc, à ce titre, l’une des modalités les plus efficaces qui soit et sans mauvaises surprises.
Coachs et PME : une communauté d’état d’esprit
Coachs et PME se retrouvent bien souvent dans des valeurs communes et partagées :
La flexibilité. Cette qualité fait l’attractivité du coach, exerçant seul ou en petite structure et constitue souvent la raison du succès de la PME sur son marché.
Le sens de l’opérationnel. Toujours orienté solution, le coaching cherche à améliorer comportement et méthodes dans « l’ici et maintenant » et en partant de l’expérience. Prise dans un rythme soutenu de croissance et de résultats, la PME valorise l’opérationnel et le pragmatisme par rapport au politique.
Le désir de progrès. La demande de progrès d’une PME est le premier matériau du coach : impliquée dans sa démarche d’amélioration, la PME s’investit dans le coaching, met en œuvre les moyens proposés et en retire une grande efficacité.
Accompagner le progrès, la croissance et la volonté : telle est la mission valorisante fixée à toutes les parties prenantes, le coach, les dirigeants et les managers.
Dotées de valeurs proches de celles véhiculées par les coachs professionnels, les PME disposent intrinsèquement de tous les atouts pour bénéficier pleinement du coaching et faire fructifier ses résultats.